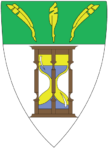« L’élève au centre » est devenu le mot d’ordre de toutes les politiques d’éducation modernes. Des slogans comme « de Schüler do ofhuelen wou en ass » reflètent une volonté d’assister l’élève le plus étroitement et le plus individuellement possible dans son apprentissage. Des structures et des postes en grand nombre ont été créés pour se plier le mieux possible aux besoins de chaque enfant.
Cette manière de procéder comporte cependant deux problématiques majeures. Tout d’abord, elle met le poids sur les faiblesses. Les initiatives, les mesures et les institutions qui ont foisonné ces dernières années visent presque toutes à refaire des retards, à rattraper des lacunes, à compenser des troubles d’apprentissage, à satisfaire des besoins spécifiques. Rares sont celles qui s’intéressent à développer des capacités particulières au-delà et en dehors des programmes, indépendamment de quelque trouble ou difficulté particulière. Les programmes en tant que tels sont évidemment à l’origine de cette problématique. Tant qu’on évalue le niveau des élèves par la distance qui les sépare du programme, on est dans une logique verticale où les forts sont ceux qui sont proches du programme et les faibles ceux qui en sont loin et qu’il faut en rapprocher. En se rendant compte que dans la même logique les programmes se bornent à ce qui se laisse le mieux définir et le mieux mesurer – en gros le calcul et l’orthographe – on a une idée de l’étroitesse de ce monde.
La deuxième problématique est la suivante : mettre l’élève au centre ne l’enferme pas seulement dans les faiblesses et dans les programmes, mais aussi dans lui-même. Toutes les aides ne visent finalement que son propre avancement, sa propre carrière, sa propre réussite, sa propre conformité. Tous ces éducateurs appliqués à s’occuper de l’intérêt de chaque élève, ne serait-il pas temps qu’ils s’occupent de l’intérêt de nous tous ?
Au lieu de pousser les élèves dans la course aux programmes, au lieu de les plaquer sur des questions dont tout le monde connaît la réponse, ne feraient-ils pas mieux d’attendre et d’exiger des jeunes gens qu’ils se saisissent des questions du monde présent, complexe et incertain, et qu’ils essaient de trouver des réponses nouvelles, meilleures que celles que nous avons trouvées et que nous appliquons toujours ?
Que faut-il encore pour que le monde de l’éducation comprenne que le temps presse, que le monde doit évoluer urgemment, l’économie, la politique, la science, la culture, parce que les règles actuelles ne sont plus les bonnes et qu’il devient absurde et dangereux de les perpétuer ? Au lieu de l’élève, il faut mettre le monde au centre des préoccupations, d’abord les autres, la classe, la communauté, la société, l’espèce humaine, la nature, l’avenir. L’élève devient acteur, non plus seulement de son propre apprentissage, mais du monde. Il apprend non plus seulement pour lui-même, mais pour contribuer à la bonne marche du monde, au bien-être général. S’engager devient une nécessité, une mission, une chance, un honneur. Cette perspective le transforme et le forme, c’est la communion de l’intérêt individuel et de l’intérêt collectif.