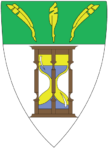Pourquoi Ermesinde?
Pourquoi Ermesinde ?
(article publié en 2011)
La création du lycée–pilote, nommé dans un premier temps « Neie Lycée », remonte à l’an
2005. Un nom ne lui avait pas été assigné au départ. Il avait plutôt été décidé d’attendre qu’un
nom se dégage au fil du temps à travers diverses expériences et considérations, internes et
externes. A présent que le lycée s’apprête à emménager dans ses installations définitives
situées à Mersch, le moment est venu de lui attribuer un nom officiel.
Le lycée n’a cessé d’attirer des élèves et des parents en provenance de toutes les régions du
pays. C’est pourquoi un nom d’envergure nationale a été préféré à un nom d’ordre local.
L’intérêt pour les concepts pédagogiques du lycée dépasse les frontières de notre pays. Le
lycée accueille souvent des stagiaires français et allemands et son conseil scientifique se
compose de professeurs d’université venant de plusieurs pays d’Europe. De plus, le lycée
mise beaucoup sur le multilinguisme caractéristique de notre société, en instaurant dès l’âge
de douze ans une pratique étendue des langues étrangères. Autant de raisons pour lesquelles
un nom a été recherché tenant de la culture et de l’histoire allemandes et françaises, et
pouvant se prévaloir de surcroît d’une dimension européenne.
En raison des travaux de recherche qui leur sont demandés, les élèves du lycée–pilote ont
l’expérience des connaissances historiques qui émergent continuellement dans toutes les
branches, contribuant à une culture générale étendue. Nombre de ces connaissances ont
disparu ces dernières années des programmes nationaux et européens. Les exigences du lycée
en matière de recherche et de présentation ont le mérite de rehausser le caractère
interdisciplinaire de l’histoire et son rôle primordial dans l’acquisition d’une culture générale
et critique. C’est pourquoi l’idée est venue de choisir un personnage historique dont la vie et
l’époque sont particulièrement riches et importantes à connaître.
Dans la suite, ces aspects seront développés et d’autres y seront rajoutés, faisant apparaître
que le nom de la comtesse Ermesinde sied d’une façon toute particulière à une école connue
d’ores et déjà pour ses bons résultats en matière d’orientation et de culture générale, pour la
qualité de son encadrement, mais aussi pour son fonctionnement original et pour sa recherche
de cohésion sociale à travers la diversité de ses activités.
Il est utile de considérer l’ « histoire » d’Ermesinde au niveau de son histoire personnelle, de
sa vie mouvementée, marquée par des enjeux culturels et politiques d’une grande variété,
2
mais aussi et surtout au niveau des valeurs et des qualités qui ont été rattachées à sa personne
et à ses actions au fil des siècles et des relectures successives de l’histoire de notre pays.
Ermesinde compte parmi les trois personnages les plus populaires de l’histoire
luxembourgeoise, à côté de Sigefroid et de Jean l’Aveugle. Elle est connue pour avoir été à
l’origine de l’entité territoriale luxembourgeoise ayant persisté durant six siècles jusqu’à la
Révolution belge de 1830.
Pourtant, tout avait mal commencé. A la mort de son père, Henri IV de Namur dit l’Aveugle,
en 1196, la petite Ermesinde, âgée de dix ans, se retrouvait pratiquement sans terres. Namur
était passé à la maison de Hainaut, alors que les comtés de Luxembourg, Laroche et Durbuy
avaient finalement été attribués à Otton de Bourgogne, frère de l’empereur germanique Henri
VI (lui–même fils et successeur de Frédéric Barberousse). Cinquante ans plus tard, à sa propre
mort, en 1247, son fils Henri V de Luxembourg dit le Blond, hérita non seulement des comtés
de Luxembourg, Laroche et Durbuy, mais aussi du marquisat d’Arlon, reliant Luxembourg à
Laroche. C’est la raison pour laquelle Ermesinde a pu être qualifiée de « fondatrice du pays de
Luxembourg » 1 ou de « deuxième fondatrice du pays » après Sigefroid. 2 La question de savoir
si Ermesinde mérite bien cette dénomination a été posée sans complexe ces dernières
décennies (e.a. par Michel Pauly, Paul et Michel Margue, Pit Péporté), tant il est clair que la
reconquête territoriale était avant tout l’oeuvre de ses deux époux, Thiébaut de Bar et Waléran
de Limbourg, qu’elle épousa en 1198 respectivement en 1214, même si, après la mort de
Waléran en 1226, elle ne se remaria plus et finit par exercer elle–même le pouvoir aux côtés
de son fils Henri V – à partir de 1235, dès que celui–ci fut majeur – jusqu’à sa mort.
Petit relevé historiographique
Jusque dans les années soixante, on tenait à attribuer à Ermesinde seule la refondation de
notre pays. Dans les années 1930, à l’occasion entre autres de la commémoration de
l’affranchissement de la ville d’Echternach (1936) et de l’indépendance nationale (1939), elle
apparut comme une des figures les plus importantes au « Panthéon national » (Michel Pauly)
et fut comparée à la grande dame de ces temps difficiles, la Grande–Duchesse Charlotte.
C’est un enjeu primordial de l’historiographie : découvrir les associations et les pondérations
qui ont été faites à d’autres époques avec compréhension et humilité. « A se familiariser avec
d’autres temps, d’autres époques, d’autres civilisations, on prend l’habitude de se méfier des
1 Camille–J. Joset S.J., Ermesinde Fondatrice du Pays de Luxembourg, Les Amis de Clairefontaine, Arlon, 1947
2 P. Jos. Adam, Ermesinde, Gräfin von Luxemburg, Heimat und Mission 1/2 1997, p. 3
critères de son temps : ils évolueront comme d’autres ont évolué. » dit Régine Pernoud, la
fameuse médiéviste à qui revient le mérite, avec e.a. Marc Bloch, Jacques Le Goff, Fernand
Braudel, Jacques Heers, d’avoir renouvelé notre regard sur le Moyen Âge et donc sur notre
monde d’aujourd’hui. C’est aussi à ce titre que le nom d’Ermesinde convient bien à une école,
dans le sens où il s’agit d’apprendre aux jeunes de considérer qu’en tout temps, aujourd’hui
pas moins qu’autrefois, les hommes ont besoin de se réconforter et de se solidariser en se
rassemblant autour de références communes.
La Renaissance s’est davantage intéressée à l’Antiquité qu’au Moyen Âge, de sorte que chez
l’abbé Bertels par exemple, Ermesinde n’apparaît que très peu sinon par rapport aux
circonstances remarquables, pour ne pas dire miraculeuses, de sa naissance. Là encore, il est
intéressant de remarquer que l’Histoire est finalement faite d’histoires. 3 « L’histoire ressemble
parfois à un roman. » s’exclame Joset en 1947. Le petit livre de Michel Georis, également de
1947 – année du 700 e anniversaire de la mort d’Ermesinde – en fournit un autre exemple
frappant. Son contenu et son style peuvent nous sembler par moments fort éloignés, mais sans
doute les générations futures en diront autant de nos productions d’aujourd’hui.
3 D’histoires tissées par les historiographes en fonction des signes politiques d’une époque mais aussi de
légendes ou de « petites histoires » plus ou moins véridiques. Dans le cas d’Ermesinde, les premières abondent,
comme le montre de façon condensée l’article de Pit Péporté dans les Lieux de mémoire du Luxembourg (Edition
Saint–Paul, 2007, p. 61–66) – parlant d’un « rattachement progressif d’Ermesinde au culte de Notre–Dame de
Luxembourg ainsi qu’à la Grande–Duchesse Charlotte » (pour une analyse détaillée, se rapporter au chapitre
« Ermesinde : The connecting link », de Pit Péporté, dans un livre à paraître ; voir www.brill.nl/constructing–
middle–ages). Pour ce qui est des secondes, il est vrai que hélas « aucune chronique ne nous a révélé les
anecdotes qui émailleraient une biographie. » et que seulement des « actes juridiques, très secs » nous sont
parvenus (Camille–Jean Joset, Ermesinde, Les Amis de Clairefontaine, 1947, p. 79). Cela n’a pourtant pas
empêché le développement, au cours des siècles, d’un « halo de légende », partant de la naissance miraculeuse,
passant par la légende de la fondation de l’abbaye de Clairefontaine, allant jusqu’à un genre de sainteté
(ibid. p. 76). Une des plus pittoresques est sans doute la légende numéro 106 des 371 Luxemburger Sagen und
Legenden recueillies et publiées par Edmond de la Fontaine en 1882 (rééditées en 1989 par les Editions Emile
Borschette). Dicks y raconte qu’Agnès de Gueldre, troisième femme du père d’Ermesinde Henri IV l’Aveugle –
que celui–ci avait repris, supposément pour raisons politiques, treize ans après l’avoir répudiée quatre ans après
leur mariage de 1168, afin d’avoir encore une descendance directe malgré son âge avancé de 72 ans (90 d’après
Dicks) – ne serait pas la mère d’Ermesinde. Au lieu d’elle, nulle autre que Mélusine aurait partagé la couche de
Henri l’Aveugle (qui, comme le précise Dicks, portait ce nom à cause de sa bravoure, « weil er in allen Gefahren
blind zu sein schien »), après l’avoir rajeuni, et aurait enfanté Ermesinde dans le seul dessein de sa propre
libération (ayant été engloutie par le rocher du Bock après que Sigefroid eût découvert sa vraie nature). Cette
dernière n’adviendrait en effet qu’à condition qu’elle donnât naissance à dix princes accédant au trône de
Luxembourg.
Conformément à l’idéal du bon souverain absolu encore en vigueur au 18 e siècle, Jean
Bertholet, prêtre jésuite et historien, dépeignit Ermesinde comme une figure maternelle,
raisonnable et entièrement dévouée à son peuple, à l’instar de l’impératrice Marie–Thérèse,
alors régente du duché de Luxembourg. Alors même que Bertholet fut déjà critiqué de son
vivant pour ses vues historiques biaisées, l’image qu’il donna d’Ermesinde persiste en
quelque sorte jusqu’à nos jours.
Les historiens ont pourtant bien montré entre–temps que les suzerains de l’ordre féodal
n’avaient pas grand–chose à voir avec les souverains de l’Ancien Régime et encore moins
avec les Etats–nations que nous connaissons aujourd’hui. Régine Pernoud l’affirme
clairement : 4 « L’ordre féodal est très différent de l’ordre monastique qui l’a remplacé et
auquel a succédé, sous une forme plus centralisée encore, l’ordre étatique qui est actuellement
celui des diverses nations européennes ». 5 C’est un argument supplémentaire pour attribuer le
nom d’Ermesinde au premier lycée public autonome du Luxembourg. Il ne faut pas oublier en
effet que le statut de lycée–pilote qui lui fut d’abord attribué se rapportait à la responsabilité
conférée à sa première communauté de se donner un cadre conceptuel et une réglementation
propres. Sa création politique fut facilitée à l’époque par les évaluations comparatives
internationales menées après l’an 2000 qui plaçaient régulièrement en tête les nations dont les
écoles jouissaient d’une grande autonomie. Ainsi le « Neie Lycée » fut créé dès l’abord dans
un esprit « local », avec cette exigence fortement participative et rassembleuse de mettre en
place des structures autonomes susceptibles de garantir l’évaluation et le développement
continuels de ses propres principes et moyens. Une grande responsabilité fut ainsi donnée à
une communauté, engageant celle–ci à persister dans la réflexion, la discussion et la
négociation. L’existence et le fonctionnement mêmes du lycée reposent sur des relations de
confiance et de correspondance entre un ministère et une communauté d’une part, entre cette
communauté et ses partenaires de tous les jours, ses élèves et ses parents, d’autre part.
Après la Révolution française, Ermesinde aurait pu être désavouée au même titre que tous ces
souverains de jadis qu’on tenait alors en mésestime. Au lieu de cela, Ermesinde fut élevée au
rang d’une femme politique d’exception, à l’initiative notamment de Gaspard–Théodore–
Ignace de la Fontaine, gouverneur du grand–duché de Luxembourg de 1841 à 1848, père de
l’écrivain national Edmond de la Fontaine, dit Dicks. Dans les publications de la Société
archéologique, fondée en 1845, le gouverneur attribua à Ermesinde des tendances libérales,
4 Pour en finir avec le Moyen Âge, Editions du Seuil, 1979, p. 56
5 « Ce ne sont que les légistes tout–puissants à la cour de Philippe le Bel qui allaient faire du suzerain un
souverain. » (ibid. p. 66) Voir aussi Raymond Delatouche, Le Moyen Âge : Pourquoi faire ?, Editions Stock,
1986, p. 100 : « Le régime féodal opère la décentralisation maxima. »
sous prétexte qu’elle eût donné la liberté à la ville de Luxembourg. Il alla jusqu’à en faire la
fondatrice lointaine de la bourgeoisie libérale si prônée en ce milieu du 19 e siècle. C’était
naturellement, une fois de plus, sortir les choses de leur contexte. La libertas sanctionnée par
les chartes concédées aux villes d’Echternach et de Luxembourg en 1236 et 1244 n’avait pas
prioritairement de vocation individuelle. 6 Ce fut un privilège (privilegium libertatis) qui
s’inscrivait dans la logique mutuelle déjà évoquée. Le service de la comtesse consistait à
garantir la sécurité (pax et quies) et à protéger contre l’arbitraire, moyennant codification des
obligations financières. 7 A part de payer leur comtesse, les bourgeois (burgenses, par
opposition à cives) se chargeaient de diverses tâches administratives et juridictionnelles, dont
l’effet principal fut de les constituer en communauté. 8
Un cas singulier dans l’histoire occidentale : l’auto–développement
Il est de plus en plus nécessaire que nos jeunes apprennent à considérer les acquis de leur
temps avec recul et circonspection, y compris les manières et méthodes actuelles d’occuper et
d’exploiter le territoire. La concentration urbaine, la désertification des campagnes, mais aussi
l’anonymisation et la déshumanisation des relations sociales, l’éclatement des cellules locales
et familiales, sont autant de thématiques préoccupantes dont il est urgent que les jeunes
s’occupent de manière avertie. Or comment pourraient–ils le faire sans connaître d’autres
modèles leur donnant à réfléchir ? La période s’étendant du Xe à la fin du XIIIe siècle est une
fenêtre dans l’histoire occidentale dont la singularité extrême fut mise en évidence en 1971
par l’économiste italo–américain Roberto Sabbatino Lopez. Dans son fameux ouvrage The
Commercial Revolution of the Middle Ages, il proclame : « Là, pour la première fois dans
l’histoire, une société sous–développée réussit à se développer elle–même, principalement par
ses propres moyens. » 9 L’argument majeur avancé par Lopez est que, contrairement par
6 Henri Trauffler, dans Ermesinde et l’affranchissement de la ville de Luxembourg, Publications du CLUDEM,
Luxembourg, 1994, p. 233 : « La libertas qualifie une qualité accordée à une collectivité, moins une liberté
individuelle. »
7 D’après Henri Trauffler, ces dernières furent d’ailleurs fortement augmentées à l’occasion. (ibid. p. 230)
Michel Pauly (dans une émission radiophonique sur 100,7 du 29 mars 1994) suppose que d’un autre côté des
obligations en nature ont été abrogées au même moment, sans qu’on sache dire lesquelles.
8 Voir Michel Pauly, Der Freiheitsbrief der Stadt Luxemburg : herrschaftlicher Machtanspruch oder bürgerliches
Emanzipationsstreben ?, dans Ermesinde et l’affranchissement de la ville de Luxembourg, Publications du
CLUDEM, Luxembourg, 1994, p. 235–253
9 Cité par Raymond Delatouche dans Le Moyen Âge Pourquoi faire ?, p. 67–68
exemple à l’Egypte ancienne, à l’Athènes de Périclès et à l’Empire romain, « le
développement médiéval ne doit à peu près rien aux conquêtes : c’est un auto–
développement ; il s’est opéré par les propres moyens de la société agissant par elle–même et
sur elle–même. » Une des raisons pour lesquelles l’esclavage, qui avait disparu
progressivement à partir du IVe siècle et qui allait renaître massivement à la Renaissance, 10
n’était plus nécessaire avait été la prolifération des monastères : « L’initiative monastique est
une révolution sociale : l’esclavage n’est plus nécessaire au développement. » 11 Il faut saisir
en effet que le travail physique, autrefois tare de l’esclave, était devenu une part essentielle de
la vie des moines, révérés par tout le monde, alors que ces mêmes moines étaient des gens
savants, des lettrés. Ainsi réunissaient–ils en quelque sorte deux mondes et deux populations
qui jusque–là étaient foncièrement séparés : le monde rural, l’agriculture, les paysans et le
monde culturel, l’élite, les nobles 12 . C’est un exemple important de cohésion sociale : le
moine est lettré mais travaille aussi la terre, comme un paysan, sans perdre pour autant son
statut social. Au contraire, il en est grandi.
Le travail manuel et en particulier agricole s’en trouvait incroyablement mis en valeur. 13 Avec
le succès que nous connaissons et dont nous sommes aujourd’hui très éloignés : « Le Moyen–
Âge a laissé la terre incomparablement plus féconde qu’il ne l’avait reçue. » 14 Mais aussi et
surtout, alors que nous sommes aujourd’hui en train d’épuiser tous nos sols : « La méthode
traditionnelle, variable selon les lieux, n’était pas consommatrice, mais productrice de capital
foncier. » 15
Autant de différences avec l’Europe moderne dont il est crucial et urgent que les jeunes
prennent conscience. Dans notre monde occidental qui n’offrira bientôt plus que le secteur
tertiaire comme débouché, comment justifier la délocalisation totale du secteur primaire ? Est–
ce vrai que le capitalisme est une création de l’inégalité du monde, comme le prétend le
10 Pour la différence entre le servus antique, l’esclave, et le servus médiéval, le serf, voir Régine Pernoud, Pour
en finir avec le Moyen Âge, Seuil, p. 74. Pour l’esclavage à l’antique à la Renaissance, voir Jacques Heers, Le
Moyen Âge : une imposture, Perrin, p. 163 et Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Flammarion, p. 97
11 Le Moyen Âge Pourquoi faire ?, p. 113
12 Le recrutement de l’ordre bénédictin était noble.
13 Voir Le Moyen Âge Pourquoi faire ?, p. 199 : « Les établissements cisterciens deviennent des fermes
modèles. »
14 ibid. p. 70 ; « en passant d’une superficie sauvage ou abandonnée à deux tiers à un territoire cultivé dans sa
totalité cultivable, jardiné pour une bonne part » (p. 117)
15 ibid. p. 86
sociologue américain Immanuel Wallerstein ? 16 Le monde rural est–il vraiment le « grand
oublié de notre temps » ? 17 Quel est l’avenir de l’artisanat et des métiers manuels ? Voilà des
questions qui certes font l’actualité et apparaissent à présent dans les programmes scolaires,
mais comment faire en sorte que les jeunes s’en saisissent et s’engagent à les résoudre, s’ils ne
songent qu’à consommer plutôt qu’à mettre la main à la pâte ? Ne faut–il pas pour cela leur
donner l’occasion d’expérimenter un monde restreint mais complet comme peut en fournir
l’école, à condition de la doter de structures conséquentes ? Ainsi le lycée–pilote est composé
de différentes cellules, maisons et entreprises, dont chacune est vouée à exploiter un domaine
donné jusqu’à un niveau élevé de développement et de production. Chacun de ces domaines 18
est exploré dans ses dimensions techniques, artisanales, scientifiques, culturelles, historiques,
économiques, morales et sociales.
Il n’est plus contesté que l’âge féodal, l’« heureux temps de Saint–Louis », s’étendant de la
seconde moitié du Xe siècle à la fin du XIIIe, fut un « âge de grande prospérité et d’un
développement incontestable », 19 marqué par une grande cohésion sociale et une répartition
démographique qu’on n’a plus vu aussi équilibrée depuis. 20 On connaît l’expression du moine
Raoul Glaber en 1030 : « on dirait que le monde secoue ses haillons pour se parer d’un blanc
manteau d’églises ». 21 Se forma en effet un réseau villageois qui ne se modifia plus guère
jusqu’à la révolution industrielle du XIXe siècle et qui persiste grosso modo encore
aujourd’hui. Le système féodal se distingua par un double devoir de protection et de service
entre seigneurs et paysans, entre suzerains et vassaux, soit entre hommes liés par un serment
de fidélité. La formation de cellules locales et familiales fortes en fut la conséquence
naturelle : « l’homme, pendant tout le Moyen Âge, ne sait vivre seul ».22 C’est encore une
16 cité par Fernand Braudel dans La dynamique du capitalisme, Flammarion, p. 97 : « (…) il lui faut pour se
développer, les connivences de l’économie internationale. Il est le fils de l’organisation autoritaire d’un espace
de toute évidence démesuré. Il n’aurait pas poussé aussi dru dans un espace économique borné. Il n’aurait peut–
être pas poussé du tout sans le recours au travail ancillaire d’autrui. »
17 Régine Pernoud, dans Le Moyen Âge Pourquoi faire, p. 23
18 cuisine, film, livre, nature et terroir, patrimoine, spectacle.
19 Régine Pernoud ̧ Le Moyen Âge Pourquoi faire ? », p. 55 ; lire aussi p. 12 : « Les quatre siècles qui vont du Xe
au début du XIVe offrent un exemple convaincant de développement ; et cela, en exploitant ce qu’on peut
appeler les moyens du bord, sans recourir au pillage de biens étrangers, à la conquête, à l’asservissement des
autres, uniquement par une complète et méthodique mise en œuvre des ressources locales. »
20 Voir Raymond Delatouche, Le Moyen Âge Pourquoi faire ?, Stock, p. 91
21 lat. « candidam vestem ». Candidus en latin signifie blanc éclatant, mais aussi radieux, heureux, favorable,
clair, franc, loyal (Gaffiot).
22 Claude Gauvard, Le Moyen Âge, Editions de la Martinière, p. 10
différence de taille avec le monde d’aujourd’hui où l’indépendance fait parfois figure de
valeur suprême. Le lycée–pilote renonce à l’évaluation notée, purement comparative, parce
qu’elle risque d’éloigner de la coopération, de la participation et de l’engagement, donc
encore une fois de la cohésion sociale.
L’histoire déformée
Pourtant l’image qu’on voulut donner du Moyen–Âge depuis la Renaissance fut rarement
glorieuse et c’est aussi une façon de réhabiliter une époque souvent traitée avec dédain que
d’y associer le nom d’une institution consacrée à l’éducation. Nombreuses et persistantes sont
les déformations abusives et mensongères qu’on fait subir encore aujourd’hui à ce temps de
mille ans obstinément présenté comme un bloc homogène, invariablement sombre, miséreux
et archaïque. Malgré les recherches historiques nombreuses et affranchies de ces dernières
décennies, il arrive encore que des références sérieuses au Moyen–Âge déclenchent des
réactions d’incompréhension, d’incrédulité ou d’embarras. D’un autre côté, les expositions
ayant trait au Moyen–Âge attirent les foules partout en Europe et dans le monde entier depuis
des années, les cathédrales, les villages médiévaux, les abbayes, les châteaux forts accusent un
engouement croissant, leur classement libère des sommes inouïes pour leur conservation, au
grand profit des métiers d’art et de la recherche. Il vaut donc la peine de « dépasser le regain
d’intérêt touristique et folklorique des ces dernières décennies » (Jacques Heers) et de
reconsidérer sérieusement l’époque qui fut à l’origine de notre croissance millénaire,
croissance qui se poursuit encore et toujours mais qui a malheureusement et dangereusement
perdu beaucoup de l’équilibre de ses débuts.
Afin de mieux comprendre la singularité du temps d’Ermesinde, il convient de relever
quelques faits historiques, tout en se débarrassant des confusions les plus grossières.
Du côté du Luxembourg, la fenêtre historique en question s’inscrit à peu près entre la
fondation de Luxembourg par Sigefroid en 963 et la fin du règne d’Ermesinde en 1247. Pour
ce qui est de la France, cette même période correspond aux Capétiens directs, de Hugues
Capet, élu rois des Francs en 987, jusqu’à Louis IX, Saint–Louis, dont le long règne se
termina en 1270. En ce qui concerne l’Empire, son début peut être situé en 962, année du
sacre d’Othon Ier le Grand, véritable commencement de l’histoire du nouvel empire
d’Occident, 23 et sa fin en 1250, année de la mort de Frédéric II, qui marqua la fin du pouvoir
23 Voir Les dynasties d’Europe, Bordas, p. 223
impérial effectif en Allemagne et en Italie. 24 Les figures marquantes de l’époque d’Ermesinde
furent Philippe–Auguste (au pouvoir de 1180 à 1223) et Saint–Louis (de 1226 à 1270) du côté
français, Frédéric Ier Barberousse et Frédéric II du côté de l’Empire germanique.
Cette époque a été remarquablement épargnée par nombre de ces fléaux attribués hâtivement
aux « temps médiévaux ». L’essor démographique y a été fulgurant : la population de nos
contrées a triplé entre les XIe et XIIIe siècles jusqu’à un niveau qui ne sera plus atteint avant
le XVIIIe siècle. Ce fut, selon Raymond Delatouche, 25 « une réaction de santé, de vouloir–
vivre, passées (…) la décomposition anarchique de l’Etat carolingien » ainsi que les invasions
normandes, hongrois et sarrasines. Oui c’était l’époque des croisades, non ce n’était pas
encore les famines, d’entre 1315 et 1317, ni la peste noire, de 1348, ni la Guerre de Cent Ans,
de 1337 à 1453. C’était avant le roi de fer, souverain et centralisateur, Philippe le Bel,
couronnée en 1286. C’était aussi avant les procès de sorcellerie du XIVe siècle et bien avant
la réapparition de l’esclavage au XVIe et les guerres de religion, de 1562 à 1598. Non, le
procès de Galilée n’eut pas lieu au Moyen–Âge, mais au XVIIe siècle, à l’époque classique,
au temps de Descartes, cent ans après la naissance de Montaigne. Non, les œuvres antiques ne
furent pas du tout seulement redécouvertes à la Renaissance et les savants arabes ne furent pas
les seuls à les traduire. Les auteurs grecs et latins constituaient, depuis la dénommée
Renaissance carolingienne, à côté de la chanson de geste et de la « matière de Bretagne », la
« matière antique », source d’inspiration majeure des auteurs du Xe au XIIe siècle. Les
Romans de Thèbes et de Troie se répandirent dans toute l’Europe au XIIe, l’Enéide ne cessa
jamais d’être étudiée et connut elle aussi maintes traductions et réinterprétations. Les Vœux du
Paon, roman en vers de Jacques de Longuyon, 26 firent apparaître les Neuf Preux, dont
faisaient partie les trois « païens de l’Antiquité » Hector de Troie, Alexandre le Grand et Jules
César. Les épopées grecques et en particulier la légende d’Alexandre le Grand n’avaient
jamais disparu de la littérature médiévale. 27 On pourrait continuer encore longuement la liste
de toutes les omissions et déformations volontairement installées dans la mémoire collective
depuis la Renaissance. Mais comment et pourquoi tous ces efforts d’obscurcissement du
Moyen Âge, de Rabelais jusqu’à aujourd’hui ? Jacques Heers avance une explication simple
24 ibid. p. 225
25 Le Moyen–Âge Pourquoi faire ?, p. 71
26 Remarquons au passage que Longuyon est une ville située sur le chemin menant d’Arlon à Marville, où
Ermesinde eut son château, quand elle fut marié à Thiébaut de Bar, et où elle habita souvent, sa vie durant.
27 Voir par exemple La littérature française – Les grands mouvements littéraires du Moyen Âge, Librio, 2009 et,
plus particulièrement, le chapitre Le Moyen Âge : l’oubli de l’Antiquité ? dans Le Moyen Âge, une imposture, de
Jacques Heers, aux éditions Perrin.