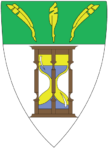Il y a des mots vénérables qu’on devrait s’interdire d’utiliser à tout escient. Cela fait des années que le terme de compétence est employé à toutes les sauces dans l’éducation. Les programmes ne sont plus faits de contenus, mais de compétences. Les objectifs d’apprentissage sont décomposés en micro-étapes s’étalant sur des années et des années et détaillés en un flot de « compétences » remplissant des centaines de pages et de listes dans les plans d’études. Chacune de ces innombrables compétences fait l’objet d’une description officielle, ainsi que d’un enseignement et d’une évaluation explicites, apparaissant dans les manuels, dans les devoirs et sur les bulletins. On se demande comment les enseignants et les parents arrivent encore à s’en sortir devant cette inflation de descripteurs et d’indicateurs abstraits.
Il est curieux de constater que toute cette industrie de compétences se situe plutôt aux antipodes de la signification originelle du terme. En principe, une compétence désigne en effet quelque chose de beaucoup plus grand, une autorité, une qualité, un pouvoir global résultant d’une somme de connaissances et d’expériences et conférant à son détenteur une expertise et un statut dignes de confiance. Il s’y ajoute que la compétence d’une personne se rapporte généralement à un domaine particulier, à savoir le domaine qu’elle a visé et cherché à atteindre (lat. petere), au même titre que les autres représentants de ce domaine (lat. com-petere).
La compétence et son acquisition ont finalement une nature organique. En évoluant longuement dans une spécialité, on finit par acquérir le savoir, la culture, la souveraineté qui en distingue les dignes représentants. La compétence relève de la pratique et de l’implicite. On l’acquiert après avoir évolué longuement dans une spécialité et dans un milieu.
Une compétence ne me semble guère pouvoir être atteinte de manière systématique. C’est plutôt à force de côtoyer une matière et de fréquenter un milieu qu’on apprend implicitement les ficelles du métier et qu’on est finalement capable, à l’instar du pianiste ou de l’organiste, d’interpréter et d’improviser.
On peut s’étonner comment cette manie de décomposer les savoirs en des compétences qui ne méritent pas le nom a pu se développer. Le lycée Ermesinde entend résister quelque peu à cette vague, en se portant, paradoxalement, défenseur de la compétence dans le sens profond du terme, afin que la qualité ne sombre pas dans la quantité.